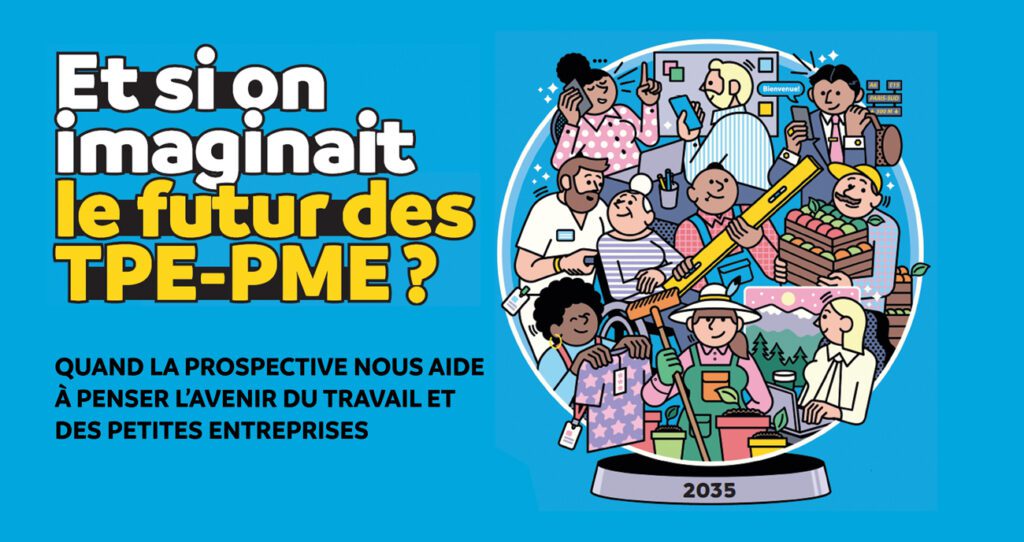Scénarios pour les TPE-PME de demain
Le modèle qui semblait immuable depuis la révolution industrielle – le salariat – s’est progressivement effacé au profit d’une économie fondée sur l’autonomie et la collaboration décentralisée. Cette transformation, amorcée dès les années 2020 avec l’expansion rapide du travail en freelance, s’est accélérée avec l’adoption massive des technologies de coordination décentralisée et l’évolution des aspirations professionnelles. En 2035, le dirigeant de TPE-PME tel que nous le connaissions a laissé place à l’« entrepreneur-orchestrateur ». Sa valeur ne réside plus dans sa capacité à gérer des salariés permanents, mais dans celle à répondre à des besoins sociétaux et humains en orchestrant des dynamiques collaboratives. Paradoxalement, la fin du salariat a ramené les dirigeants de TPE-PME à l’essence même de l’entrepreneuriat : identifier des besoins, mobiliser des ressources et créer de la valeur dans un environnement incertain. Libérés des lourdeurs administratives et des responsabilités d’employeur, ils peuvent se concentrer sur ce qui constitue leur véritable valeur ajoutée : une vision, une expertise et une capacité à fédérer des talents divers autour de projets porteurs de sens.

La réaction de…
Bertrand Martinot, économiste, spécialiste de l’apprentissage, de l’emploi et de la formation professionnelle
Ce scénario vous semble-t-il plausible ?
À l’horizon 2035, je n’y crois pas ! Et même à l’horizon 2050, je ne me prononcerais pas… J’ai beaucoup travaillé et réfléchi sur ces sujets : nous allons certainement vers un éclatement des formes d’activité, mais d’ici 2035, un noyau dur de salariat restera ultra- majoritaire. Cela ne signifie pas que les tendances au freelancing ne soient pas puissantes ou porteuses de vertus d’innovation. Mais elles ne remplaceront pas le salariat. Même si le droit s’assouplissait considérablement, le salariat resterait statistiquement très majoritaire en 2035. Les bouleversements seront importants, mais parler de « mort » ou de « fin » du salariat me paraît excessif.
Quels sont les principaux obstacles à cette « mort du salariat » ?
Le premier est juridique. Notre droit, largement jurisprudentiel, s’articule autour du critère de subordination : si vous êtes subordonné, vous êtes salarié ; si vous ne l’êtes pas, vous êtes indépendant. Des milliers de pages de jurisprudence déterminent cette subordination selon que vous contrôlez vos horaires, vos clients, votre liberté de mouvement… Le juge, en France comme ailleurs, a un biais pro-salariat. Il s’attache à la réalité des relations de travail, pas aux apparences contractuelles. Le second obstacle est économique et concerne les coûts de transaction. Recourir à des indépendants offre de la flexibilité, mais engendre des coûts importants : trouver la bonne personne, négocier un contrat et un tarif ou encore gérer l’incertitude sur la qualité du travail et la disponibilité. Pour des tâches industrielles ou des projets de long terme, ces coûts excèdent rapidement les gains en termes de flexibilité. Le prix Nobel Ronald Coase a étudié le sujet dans les années 1950-1960 : il a montré que, dans les entreprises d’une certaine taille, ces coûts de transaction dépassaient les avantages qu’ils engendraient.
Néanmoins, ces coûts de transaction restent faibles lorsque vous externalisez totalement une prestation. C’est le cas dans le monde du conseil, par exemple, qui fait beaucoup appel à des indépendants pour des compétences ponctuelles sur des dossiers spécifiques.
Dans ce cas, économiquement, cela fait sens : vous évitez de former quelqu’un en interne ou d’embaucher pour une mission ponctuelle. Et juridiquement, cela tient la route car la prestation est externalisée à un professionnel qui a d’autres clients et n’est pas dans un lien de subordination.
« Une solution serait d'instaurer un peu d’indépendance dans le salariat [...] afin que les salariés puissent réaliser une partie de leurs aspirations sans avoir à quitter ce statut. »
À l’horizon 2035, quel scénario serait donc plus probable ?
Plutôt l’émergence d’un modèle hybride : un noyau dur de salariat représentant 80-90 % du personnel d’une entreprise moyenne, complété par des éléments de souplesse. Il ne faut évidemment pas minimiser l’importance des autres formes de travail : entre le salariat et
l’indépendance, il existe tout un dégradé de statuts, allant de l’indépendant pur jusqu’au salarié sans aucune autonomie, en passant par le cadre autonome en télétravail trois jours par semaine, le salarié porté, ou encore les formes de détachement inter-entreprises.
Les dirigeants et dirigeantes de TPE-PME sont-ils bien équipés pour s’adapter au « dégradé » que vous décrivez, qui implique des modes de collaboration plus flexibles ?
Ils vont devoir développer des compétences pour aller chercher les indépendants : entretenir un réseau personnel, connaître les plateformes pertinentes, développer des capacités de négociation spécifiques. Ils devront aussi être capables de porter une double casquette : celle de patron de salariés, avec un pouvoir de coercition, et celle de partenaire commercial avec des indépendants. Ce sont des compétences que beaucoup de dirigeants, particulièrement de petites entreprises habituées au 100 % salariat, ne possèdent pas encore… C’est un enjeu de formation, mais c’est aussi la question de la poule et de l’œuf : l’indépendance se développera d’autant plus qu’il y aura des dirigeants et dirigeantes capables de fonctionner avec ce modèle.
Qu’en est-il des collaborateurs, en particulier ceux qui s’apprêtent à entrer sur le marché du travail d’ici 2035 ? Sont-ils bien préparés à ces évolutions ?
L’enseignement au lycée ne les y prépare pas. Quant aux lycées professionnels, ils s’attachent exclusivement au salariat. Dans le supérieur, la situation est déjà plus nuancée. De nombreuses grandes écoles et universités proposent des modules, voire des masters entiers d’entrepreneuriat. Mais ce n’est pas non plus indispensable d’avoir un master pour devenir indépendant ! Surtout, ce qui est frappant, c’est que les jeunes sont beaucoup plus enclins que leurs aînés à l’indépendance et à la création d’entreprise. Ils ont des attentes
différentes concernant le temps de travail et la flexibilité, qui résonnent bien avec l’indépendance. Toutes les enquêtes montrent une forte appétence des jeunes pour ce mode de travail.
Cette aspiration à l’indépendance doit être considérée comme un signal d’alerte – même si seule une petite fraction franchira le pas. Les entreprises doivent démontrer qu’on peut réaliser une partie de ses aspirations tout en restant salarié – sinon, elles risquent de perdre leurs meilleurs talents. Une solution serait donc d’instaurer un peu d’indépendance dans le salariat – flexibilité des horaires, autonomie, management moins hiérarchique… –, afin que les salariés puissent réaliser une partie de leurs aspirations sans avoir à quitter ce statut.